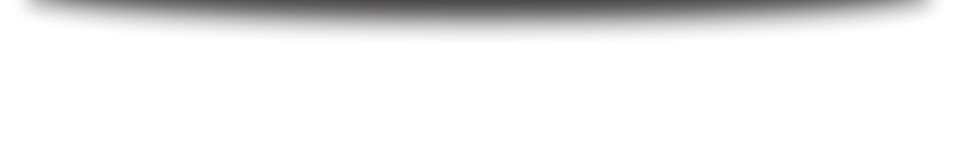Situation de la vitiviniculture vaudoise
Les résultats de l’étude de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise intitulée «Le beau menace ?» fait le point de la situation de cette branche emblématique du canton.
Entre 1989 et 2014, la production des vins vaudois a baissé de moitié (-54%), pour s’établir à 246’886 hectolitres. En cause, le renforcement de la concurrence des vins importés, en particulier dans le domaine des blancs, après l’ouverture progressive du marché suisse entre 1991 et 2001. Le recul de la consommation de vin dans le pays accentue encore la tendance selon Jean-Pascal Baechler, auteur de l’étude. Au niveau de la production, la recherche de la meilleure qualité a eu pour effet la diminution des rendements, pour une surface du vignoble vaudois restée pratiquement inchangée, à 3778 hectares.
Une tendance nationale
Dans son ensemble, la production vinicole suisse a baissé de 46,6% en 25 ans. Le vignoble vaudois s’inscrit dans une tendance similaire, avec des nuances régionales. Au sud du canton, La Côte, Lavaux, Dézaley, Calamin et le Chablais, qui représentent environ 90% de la production, ont subi de manière plus accentué les effets de l’ouverture du marché. En cause, l’encépagement du vignoble axé majoritairement sur les cépages blancs. De leur côté, Bonvillars, les Côtes-de-l’Orbe et le Vully, qui produisent les dix autres pourcents, dont les vignes sont plus présentes dans le rouge, ont connu des reculs moins marqués.
Conquérir le marché alémanique
Les initiatives permettant au consommateur d’entrer en contact avec les vins vaudois se sont multipliées ces dernières années: dégustations organisées par les vignerons, caves ouvertes cantonales, etc. Autre signal positif: malgré la problématique du franc fort, les prix de vente en grande distribution ont légèrement progressé en 2014. De sorte qu’aujourd’hui, considérer l’avenir de la branche avec un optimisme prudent semble possible, tel que l’indique le choix de cette expression typiquement vaudoise comme titre de l’étude.


L'ACTUALITÉ DU VIN
Étude de marché




1er WEBMAGAZINE DU VIN, DE LA BIÈRE ET DES SPIRITUEUX





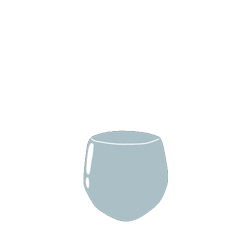
LES + POPULAIRES
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

SERVICES PRO
NOUS PROPOSONS DIFFÉRENTS SERVICES LIÉS
AU MARKETING DU VIN. DÉCOUVREZ-LES DÈS MAINTENANT SUR




SUISSE - FRANCE - BELGIQUE
LUXEMBOURG - QUÉBEC

2015-2023 © Tous droits réservés - RELAIS DU VIN & RELAIS COM Sàrl - Agence de communication globale